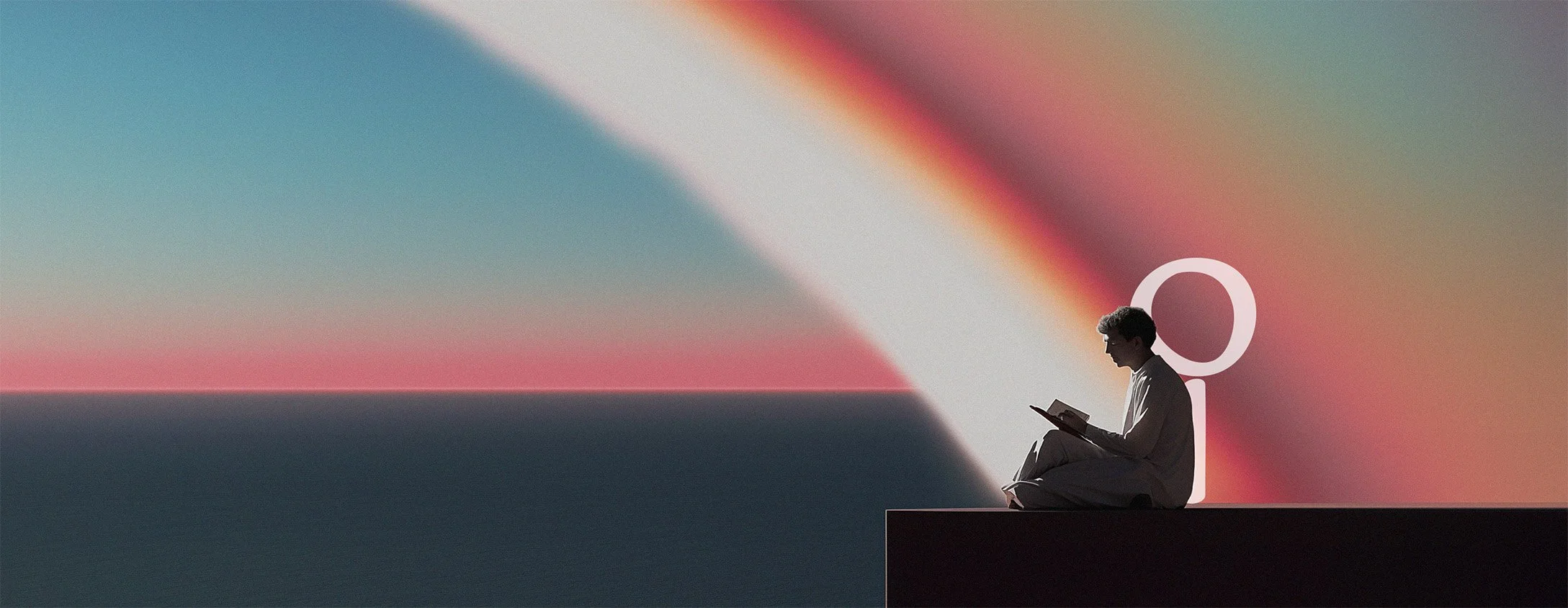
À lire, à penser
Articles & Tribunes
La responsabilité imaginative des marques
Face à une sphère politique en manque de souffle et d’imagination, la question envers l’entreprise s’impose. C’est précisément la fonction des marques de concurrencer le réel par des images, de « faire mythe », d’offrir des représentations, un spectre de valeurs et d’univers narratifs, qui vont participer à renouveler les imaginaires d’une époque.
Tribune parue dans Les Echos le 16 novembre 2024.
Plusieurs mois après la fin des JO, sa parenthèse d’optimisme et l’encensement de la résurgence de l’esprit français, comment les marques et les entreprises françaises envisagent-elles leur rôle dans la dynamisation des imaginaires ? Dans une période sous contraintes, qui oblige de plus en plus à la sobriété, comment maintenir un espace vivant, projectif, au-delà de la morosité ambiante ?
Face à une sphère politique en manque de souffle et d’imagination, la question envers l’entreprise s’impose. D’abord parce que c’est précisément la fonction des marques de concurrencer le réel par des images, de « faire mythe », d’offrir des représentations, un spectre de valeurs et d’univers narratifs, qui vont participer à renouveler les imaginaires d’une époque.
Et dans un espace d’expression saturé par les appels à une forme générale et nécessaire de frugalité, dans le champ de la marque et de l’entreprise, la modération ne doit pas pour autant signifier vide et absence de rêve. Il y a même urgence à réconcilier sobriété et désirabilité, à stimuler des récits porteurs de rêve à l’endroit même de la responsabilité des entreprises. Car les récits ont une fonction performative. En activant les facultés d’imaginant du récepteur, ils l’invitent à une participation intime et enclenchent des comportements d’incarnation et de transformation dans le réel même.
En cela, l’engagement consensuel des marques en faveur de la RSE ne doit pas être que contrainte : au contraire, il doit ouvrir et favoriser des espaces d’expression nouveaux. Car il n’y pas de contradiction entre responsabilité et rêve, il y a même, du côté de l’entreprise, une véritable responsabilité à faire rêver. Le chercheur Raphaël Llorca insiste dans ses travaux sur ce qu’il appelle, au-delà de leur responsabilité sociale et environnementale, la « responsabilité narrative » des marques, notamment du fait de l’influence qu’elles ont sur l’espace public.
Avec, pour les marques, deux gageures. La première : sortir d’un imaginaire univoque et indifférencié. La vague des « entreprises à mission » et des supposées ‘normes’ d’expression RSE conduit à une uniformisation du langage des marques et à un surinvestissement des univers de l’outdoor et de la nature, y compris pour des marques a priori éloignées de ces univers, en particulier dans le luxe. Construire des imaginaires et des univers langagiers spécifiques constitue un enjeu-clé. La Communauté des entreprises à mission elle-même insiste sur l’importance de la singularité des expressions de marque, comme gage de performance de la mission. Deuxième gageure : échapper aux effets de dissonance. Il est en effet difficile de promouvoir des valeurs à l’encontre des modes de consommation induits par le service ou le produit lui-même. Certains secteurs d’activités sont à ce titre plus délicats que d’autres. Reste que la marque est toujours dépositaire au-delà du produit, d’une vision du monde, d’une façon de faire société, et qu’elle peut porter des messages, des images, des émotions, sur des façons de faire lien, de s’inscrire dans le monde, qui peuvent contribuer précisément à le transformer.
Pour revenir à l’empreinte des JO dans l’imaginaire collectif, il y a, pour renouveler les récits de marque, et comme l’ont fait les créatifs de l’événement, matière à puiser dans les ressources de l’identité créative française : l’esprit français dans son mélange d’esthétique classique et de fantaisie, l’éclectisme, la vitalité des régions françaises, les idéaux républicains et leur réinterprétation...
Exemple récent, la manière dont la marque automobile française Renault s’approprie l’idée française de la révolution dans son dernier film R5REVOLUTION, point d’orgue de sa campagne de lancement de la Renault 5 100% électrique. Le film y reprend à son compte magnifiquement l’impertinence et l’esprit d’avant-garde français, toujours vivaces donc.
Les acteurs de la montagne doivent agir
Les stations ne sont pas les seules concernées par la transformation du modèle ‘sport d’hiver’ : de nombreux acteurs sont investis dans son économie, servent le territoire de la montagne et contribuent à sa vitalité touristique et donc à sa survie… Ne faut-il pas les rappeler à leur « principe de responsabilité » ? Quand on est acteur de la montagne, quand on y est historiquement investi, n’est-on pas aussi dépositaire de son avenir ? Et n’y a-t-on pas à ce titre un devoir d’agir ?
Tribune co-écrite avec Tom Wallis, parue dans Les Echos, le 1er juin 2022.
Le Salon Mountain Planet 2022 s’est achevé sur une image ostensiblement positive, autour d’une dynamique continuée de la montagne, et ce, au terme d’une saison exceptionnelle pour les stations françaises — occultant les perspectives pourtant bien sombres du territoire et de l’économie de la montagne.
Le second volet du sixième rapport du Giec livrait en effet en février dernier des projections pour le moins préoccupantes avec, au-delà de la confirmation de la baisse de l’enneigement, des prévisions de forte sécheresse laissant augurer une compétition accrue pour la ressource en eau. Et même si les chiffres de fréquentation étaient au rendez-vous cette année, la pratique du ski est en diminution constante.
Diminution inéluctable de l’enneigement, fragilisation des massifs et des éco-systèmes, perte d’attractivité hivernale, défi de la qualité paysagère, nouvelles dynamiques de pratiques, structure d’hébergement et d’offre majoritairement obsolète… le constat du défaut de durabilité du système touristique des sports d’hiver est unanimement partagé. Pourtant, les évolutions restent minces, limitées à des territoires sous tension, et les discours de réjouissance sur la saison passée témoignent de l’attachement à un modèle monoculture.
Malgré des initiatives de soutien des pouvoirs publics (comme le Plan Avenir montagnes), la résistance à expérimenter des programmes de transition persiste. La confiance parfois aveugle à l’égard de la technique pour maintenir l’offre neige montre la dépendance du système économique des stations françaises à l’or blanc mais aussi les difficultés d’articulation d’une gouvernance ‘éclatée’ pour engager une véritable transformation — un écueil que n’ont pas d’autres pays bénéficiant d’une gestion plus concertée.
Alors, comment sortir de la tyrannie court-termiste ? Comment accélérer ? Aujourd’hui, les stations ne sont pas les seules concernées par la transformation du modèle ‘sport d’hiver’ : de nombreux acteurs sont investis dans son économie. Opérateurs, acteurs de la distribution et des services, marques outdoor, marques d’hébergement et de loisirs, servent aujourd’hui le territoire de la montagne et contribuent à sa vitalité touristique et donc à sa survie… Ne faut-il pas les rappeler à leur « principe de responsabilité » selon l’impératif de Hans Jonas ? Quand on est acteur de la montagne, quand on y est historiquement investi, n’est-on pas aussi dépositaire de son avenir ? Et n’y a-t-on pas à ce titre un devoir d’agir ?
• Premier devoir des acteurs de la montagne : anticiper. Dans un secteur fortement imprégné par l’évolution des modes de vie, il importe plus qu’ailleurs d’anticiper et de contribuer au renouvellement des usages. Mettre au jour de nouvelles pratiques récréatives et de nouveaux actes consommatoires plus en lien avec les besoins de sens, de nature, de bien-être…
• Deuxième devoir des acteurs de la montagne : innover. Pour créer un appel d’air en faveur des stations et soutenir leur chemin de transition, il est urgent d’explorer d’autres modèles, en matière d’infrastructures, de mobilité, sur le plan des services, des modes de gestion et en pariant ouvertement sur la circularité, l’autonomie, la ‘valeur’ du territoire.
• Troisième devoir des acteurs de la montagne : nourrir le rêve. Face au caractère éculé de l’or blanc inscrit dans le modèle d’exploitation intensive de la montagne, il y a un devoir à faire rêver autrement sur la montagne. Intensité paysagère, expérience sensible, vitalité ou déconnection, les visages possibles d’un nouvel imaginaire sont nombreux.
Certes des marques essayent, innovent, investissent le territoire de la montagne. Des acteurs référents ont fait des pas de géant. Et les autres ? A quand de nouvelles idées récréatives capitalisant sur la verticalité de la montagne ? A quand de véritables modèles de coopération au service d’une approche de ‘destination’ ? A quand des lieux d’apprentissage actifs en pleine nature ?
Il est temps pour les acteurs et marques françaises de se mettre au niveau de leur responsabilité. De passer de l’intention à l’action. Et d’honorer leur tribut à la montagne.
Le monde s’invente avec le design
Dans une société qui se sépare plus qu’elle ne se relie, se fait criant le besoin de «reliance», selon le terme d’Edgar Morin. Agir, innover face à l’évolution permanente de son environnement, assumer cette culture du risque et de la rupture, construire des dynamiques collectives… de plus en plus d’entreprises et de décideurs se sont mis au diapason. Et l’on assiste à une véritable extension du domaine du design.
Tribune parue dans Les Echos le 26 janvier 2018, dans le cadre de la publication du livre «Les nouveaux territoires du design», par la Fondation ESDL Design.
Dès 2006, Klaus Schwab, le patron de Davos, annonçait l’arrivée de la « design economy ». Dix ans plus tard, il publiait « La quatrième révolution industrielle » et se félicitait du changement dans la façon de parler de la technologie et de son impact dans le monde. La même année, à Davos, le président de Tarkett vantait son modèle de « design en circuit vertueux » (closed-loop circular design) et sa contribution à une économie dynamique fondée sur la collaboration et l’innovation. Cette année, c’est sous les auspices de « la coopération renforcée dans un monde fracturé » qu’est placé le Forum économique mondial, alors même que Klaus Schwab propose cette fois de passer de la conscience à l’action, avec son nouvel ouvrage : « Façonner la quatrième révolution industrielle » (Shaping the fourth industrial revolution). Pointant la nécessité de nouvelles façons de penser et d’agir pour tous les acteurs, dirigeants et décideurs, les enjeux pour les entreprises d’expérimenter toujours plus avec les technologies, et notre responsabilité à tous de construire un futur technologique, accueillant et durable.
C’est un double appel au design qui est lancé là. Appel à cette culture du faire et de la prise de risque, d’abord, inhérente à l’approche design et qui permet de repenser la chaîne de valeur et les modèles économiques à l’écoute des besoins émergents et dans le souci constant de production de solutions globales opérantes. Appel aussi à la transversalité propre au design, dans sa volonté de renforcer l’efficacité systémique des entreprises, des interlocuteurs, des environnements. Dans une société qui se sépare plus qu’elle ne se relie, se fait criant le besoin de « reliance », selon le terme d’Edgar Morin, qui avait anticipé plus que quiconque le sens et la responsabilité du liant, de l’approche systémique, de la coopération renforcée dans un monde de plus en plus séparé, fragmenté et incertain.
Agir, innover, face à l’évolution permanente de son environnement, assumer cette culture du risque et de la rupture, construire des dynamiques collectives… de plus en plus d’entreprises et de décideurs se sont mis au diapason. Et l’on assiste à une véritable extension du domaine du design. Design de service, design d’innovation sociale, design d’interface ou d’interaction, éco-design, éco-développement, aménagement des espaces publics, des paysages, méthodes de management..., levier de transformation technologique et sociale, le design est partout.
Dans son livre collectif «Les nouveaux territoires du design», qui vient de paraître, la Fondation ESDL Design explore ce périmètre élargi du design. L’ouvrage y replace le design au cœur des modèles de valeur des entreprises, insiste sur le croisement des disciplines, met en avant les opportunités — et aussi les responsabilités — que portent les nouvelles technologies et les données pour notre futur et montre l’impact du design dans nos vies et dans notre rapport au monde.
Car le design a surtout cette faculté de donner de la signification aux objets et aux environnements qu’il repense. Par lui, l’objet se charge de chaleur, d’empathie, de valeur. Il optimise la fonctionnalité de façon à faire naître des qualités à la fois esthétiques et éthiques, il fait se conjuguer le beau et le bon, l’utile et le plaisir. Il participe à une vision renouvelée du monde. En 1974, Herbert Simon, le prix Nobel d’économie, avait cette formule : «est design tout processus finalisé se proposant de modifier l’ordre des choses du monde en un monde jugé plus satisfaisant».
Alors que le Royaume-Uni s’est doté d’un Design Council depuis la fin de la Second Guerre mondiale, dans un pays où son importance pour le développement économique est comprise depuis longtemps, l’appel à un ministère du design et au développement d’une culture design en France n’a pour l’instant toujours pas été entendu.
Dans le contexte français d’une sous-évaluation de la valeur ajoutée du design par les entreprises, avec une perception du design encore largement limitée au style, la publication de cet ouvrage participe de cette évangélisation nécessaire de la dimension stratégique du design. A travers le large spectre de ses contributions et des domaines qu’il interroge, il montre l’actualité et surtout l’acuité de l’approche design dans la construction du monde et des usages de demain.
La quête du bien commun au service de l’entreprise
Dans cette période de tension sociale extrême que nous traversons aujourd’hui, qui semble plutôt marquée par l’affirmation voire la tension des égoïsmes, ce « vivre pour autrui » peut paraître peu perceptible, voire paradoxal. Pourtant, il semble que ce soit aussi une mutualisation des égoïsmes, une convergence des luttes, qui soit recherchée, et on ne peut s’empêcher de voir dans cette quête, dans cette revendication d’un « mieux », la recherche aussi de la construction d’un commun.
Tribune parue dans Les Echos à l’occasion de la parution de l’ouvrage « Bien commun et entreprise : Regards croisés sur les nouvelles responsabilités de l’entreprise » par l’association Communication&Entreprise, aujourd’hui l’association nationale des Communicants.
Il y a quelques années, l’académicien des sciences, Philippe Kourislky, dans son ‘Manifeste de l’altruisme’, avançait que les libertés individuelles étaient certes limitées par celles des autres mais aussi et surtout construites grâce à elles. Une interdépendance renforcée encore par la mondialisation, constatait-il, épousant par là une vision organique de la société, à l’image d’autres observateurs et défenseurs de l’avènement d’une société altruiste, de Matthieu Ricard à Tania Singer ; l’altruisme serait dans nos gênes, les initiatives citoyennes partout à travers le monde reflèteraient cette réalité.
Dans cette période de tension sociale extrême que nous traversons aujourd’hui, qui semble plutôt marquée par l’affirmation voire la tension des égoïsmes, ce « vivre pour autrui » peut paraître peu perceptible, voire paradoxal. Pourtant, dans les différents mouvements à l’œuvre en France en ce moment, dans le mélange des attentes et des doléances, il semble que ce soit aussi une mutualisation des égoïsmes, une convergence des luttes, qui soit recherchée, et on ne peut s’empêcher de voir dans cette quête, dans cette revendication d’un « mieux », la recherche aussi de la construction d’un commun.
S’exprime là sur le terrain de la cité et de la chose publique, cette tendance de fond observée aussi dans la sphère privée, où la volonté d’autonomisation, de consommation égoïste, s’accompagne d’une nouvelle éthique soucieuse de l’autre, des retombées sur l’autre, et donc d’un vivre pour soi qui inclut la réalité de l’autre et de son besoin, ou tout au moins la nécessité d’un moindre mal à son encontre… Un individualisme plus altruiste, s’il en est, propre à ce qu’Alan Fairninghton appelle « The Age of selfish Altruism ».
Dépositaire d’un rôle économique et social grandissant, dans un système où l’Etat ne peut pas tout, l’entreprise n’échappe pas à cette vague de fond, à cette attente, à cette injonction, de ‘bien commun’. C’est ce que met au jour l’association Communication & Entreprise dans l’ouvrage qu’elle vient d’éditer : « Bien commun et entreprise : Regards croisés sur les nouvelles responsabilités de l’entreprise ». Ainsi, alors que sa vocation et son objet social ont toujours été par nature plutôt égoïstes, centrés vers la recherche de profit, l’entreprise aujourd’hui semble devoir se tourner vers l’autre, dans un mouvement de partage et de réciprocité, ou tout au moins d’intérêt mutuel bien compris.
Et ce mouvement ne paraît pas seulement réservé à certains types d’entreprises, à vocation solidaire ou philanthropique. C’est bien l’ensemble des projets collectifs industriels ou de service qui sont aujourd’hui pris dans ce nouvel horizon de sens et de valeur.
La prise en compte de l’autre, un nouveau prisme pour l’entreprise ? C’est ce qui semble émerger des nouvelles définitions de l’entreprise, que l’on veut désormais « partenaire » (versus autonome), inscrite dans un réseau de parties prenantes, et doté d’un objet social enrichi, à bénéfice social revendiqué et/ou externalités contenues. Ce sont les théories de la valeur partagée, qui envahissent le discours des entreprises bien au-delà du champ traditionnel de la RSE, comme une nouvelle façon d’évaluer l’entreprise mais aussi d’en développer l’attractivité, auprès de ceux qui la font vivre dans la durée (consommateurs, usagers, salariés).
Pas encore pleinement intégrée dans les indicateurs de performance, cette exigence soumet l’entreprise à des injonctions paradoxales dans un contexte de forte pression économique et financière, mais elle semble faire son chemin. Au sein des communautés de travail et des politiques sociales internes, cette quête du bien commun se fait ‘bienfaisance’ ou ‘bienveillance’ et recherche de nouveaux espaces de sociabilité.
Dans une économie « nouvelle », à la recherche d’autres modèles de croissance et de service, elle se concrétise dans une vision de l’entreprise repensée en fonction de l’usage et du service donné, envisagé collectivement. Elle se nourrit surtout d’autres investissements, plus responsables.
De l’apport de valeur pour les usagers au capital « altruiste », le bien à l’autre ne serait-il pas un nouveau levier — de développement, d’attractivité, de croissance — de l’entreprise ? Et, pour reprendre les mots de Jacques Attali, l’altruisme ne serait-il pas une forme intelligente d’égoïsme ? A l’heure où les modèles d’entreprise sont remis en question, ces enjeux de sens sont déterminants. « In the Age of selfish altruism, image is nothing, substance is everything », observait déjà Alan Fairnington.
